
2020 se termine mais la crise commencée il y a un an, elle, est loin d’être terminée. L’espoir de voir l’épidémie disparaître au printemps s’est évanoui et nous semblons nous être installés pour longtemps avec elle. Il est difficile de ne pas se laisser gagner par le pessimisme. Et pourtant il existe des raisons d’espérer. Ne faisons pas comme l’écrivain Stefan Zweig, qui s’est suicidé par désespoir durant la Seconde Guerre mondiale, pensant que tout était perdu au moment même où le sort tournait en faveur des alliés.
Zweig, auteur mondialement célèbre qui connut la gloire littéraire dès les années 20, se suicide avec son épouse le 22 février 1942. C’est la période la plus noire de la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne nazie triomphe. Après avoir écrasé l’Europe de l’Ouest, elle a brutalement envahi l’URSS et avance triomphalement. Rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur nazi. Trois mois plus tôt, son allié japonais, déjà solidement implanté en Asie qu’il met à feu et à sang, a détruit la base américaine de Pearl Harbor dans une attaque audacieuse, et fait vaciller l’Amérique, prise totalement par surprise. L’issue ne semble faire guère de doute. La Grande-Bretagne résistante mais épuisée, l’Europe soumise, l’URSS bientôt vaincue, l’Amérique circonscrite par le Japon, les dés semblent jetés. Dans un livre magnifique, Le monde d’hier, Zweig pleure un monde cosmopolite et largement insouciant dont il sait qu’il ne reviendra pas et lorsqu’il considère l’avenir, ne voit aucune raison d’espérer.
Et pourtant Zweig se trompe. Au moment même où, après une longue errance, il juge que tout est perdu et que la barbarie a triomphé, les germes d’un incroyable retournement sont déjà là. L’Amérique, apparemment terrassée à Pearl Harbor, est en fait à peine égratignée, et se met en ordre de marche pour mobiliser sa formidable puissance industrielle, d’abord lentement, puis de plus en plus rapidement et massivement. Encore seulement neuf mois et les alliés débarqueront en Afrique du Nord ; encore à peine un an, et l’armée allemande capitulera de façon retentissante à Stalingrad. Zweig pleure sur un passé chéri, et n’arrive pas à distinguer les germes du renouveau, les raisons d’espérer. Difficile de lui en vouloir ; nombre de ses contemporains, et pas les moins intelligents, ont éprouvé la même difficulté. Mais certains y sont arrivés : c’est notamment le cas du Général de Gaulle dans son discours du 18 juin 1940.
Une compréhension profonde de la situation pour dégager des pistes d’action
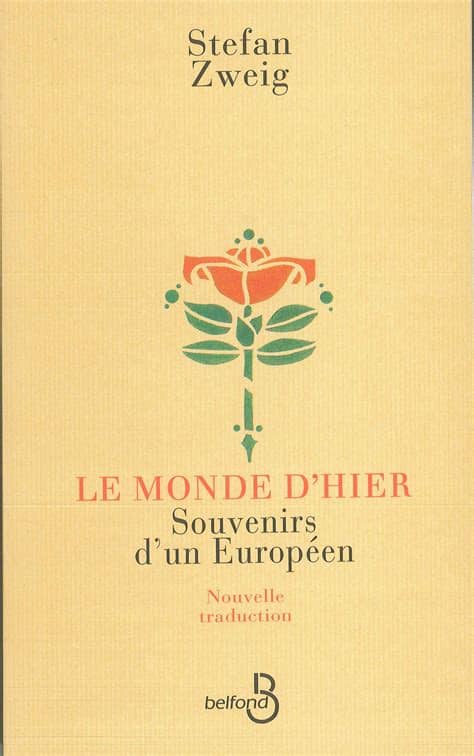
La France vient de subir une défaite terrible. Le général en prend acte en deux phrases ; il accepte la dure réalité, mais il se concentre sur ce qui va se passer ensuite. Son analyse est lucide, et prophétique : derrière la fumée de la bataille, de l’exode et de l’effondrement du pays, il observe qu’il existe des forces immenses qui n’ont pas encore joué : l’empire français, l’Amérique, et les forces mécaniques. La France a perdu une bataille, mais si elle sait jouer de ces forces, elle pourra gagner la guerre aux côtés de ses alliés. Ce que réussit à faire de Gaulle en ces jours sombres, c’est précisément de développer une compréhension profonde du présent, et notamment des forces sur lesquelles il va pouvoir agir, plutôt qu’une vision ambitieuse de l’avenir, sur lequel il reste très flou. Pas une fois il ne parle du passé. Pas une fois il n’évoque des fautes ; il est entièrement concentré sur l’analyse du présent et de ce que celui-ci porte en germe. C’est d’autant plus audacieux qu’il n’est qu’un général de brigade nommé à titre temporaire, quasiment seul et sans moyens.
Si l’on doit parler de vision gaullienne à ce moment, c’est cela : une lecture du présent et un sens donné à ce qui se passe, pour dégager des actions possibles. Il n’a pas grand-chose, mais il va agir avec ce qu’il a – sa vision de la situation et les (rares) gens qui sont avec lui.
Trois raisons, au moins, d’espérer
L’année 2020 a été à bien des égards moins tragique que la période de la guerre, bien sûr, mais elle fut éprouvante. Soixante mille personnes sont mortes en France de ce qu’on a d’abord pris pour une mauvaise grippe. Le choc terrible de mars a fait craindre un effondrement complet de notre système économique et social. On a craint des pénuries. On craint désormais une forte récession économique, un chômage massif et une dislocation du système social. Sans compter que l’épidémie est loin d’être terminée. La tentation de sombrer comme Zweig dans le pessimisme est forte. Et pourtant, comme durant la guerre, il y a, dans cette masse de mauvaises nouvelles, de véritables raisons d’espérer. J’en vois au moins trois.
La première, c’est que notre système a résisté à un choc violent et profond. Il ne s’est pas effondré, malgré les prédictions les plus pessimistes. On nous prédisait des pénuries et chacun stockait des pâtes et des sardines pour s’en prémunir. Certains même, comme Yves Cochet, cachaient à peine leur joie en mars lorsque l’effondrement, qu’ils annonçaient depuis plus de vingt ans, semblait enfin arrivé. Mais le système a tenu. Il n’y a pas eu de pénurie. Non seulement notre système ne s’est pas effondré, mais il a même montré sa solidité, au contraire de ce que décrivent les commentateurs qui évoquent souvent sa fragilité. Ce que le choc de mars a montré, ce n’est pas que notre système est fragile, c’est au contraire qu’il est incroyablement solide.
La seconde raison d’espérer, c’est que nous avons été capables de mettre au point non pas un, mais plusieurs vaccins contre la Covid. Avoir été capable de faire cela en quelques mois seulement est un exploit extraordinaire. Jamais dans l’histoire de l’humanité cela n’avait été accompli. Cet exploit n’est pas le fruit du hasard. Il n’est pas le produit d’un ou deux génies travaillant dans leur coin. Il est le produit d’un système. C’est un système sociotechnique, associant chercheurs, laboratoires publics et privés, entreprises pharmaceutiques, entrepreneurs, états, agences de santé, financiers, bref tout un réseau d’acteurs individuels et collectifs, qui a produit ces vaccins. C’est ce système, auquel on donnera le nom qu’on voudra, qui est en train de nous sauver la vie.
La troisième raison, c’est que ce système qui a permis les vaccins repose sur une coopération mondiale. Pour ne prendre qu’un exemple, le premier vaccin produit par BioNTech et Pfizer a été inventé par des entrepreneurs turcs installés en Allemagne coopérant avec des scientifiques suisses et un laboratoire pharmaceutique anglais et financé par des investisseurs de plusieurs pays, et il est fabriqué en Belgique. Au contraire de ce que nous annonçaient les pessimistes, que ce soit pour les masques ou les vaccins, c’est à l’ouverture au monde que nous devons notre salut.
Post tenebras spero lucem
Comme en 1942, la fin de l’épreuve est encore loin et il y aura d’autres batailles, dont certaines seront perdues, mais les raisons d’espérer sont là, au premier rang desquelles se trouve l’incroyable pouvoir de l’innovation et de l’entrepreneuriat, traduisant le génie humain capable d’inventer des solutions aux problèmes qui nous sont posés, mais à condition que nous ne soyons pas aveuglés par le pessimisme. Et si, durant les soirées probablement moroses des 24 et 31 décembre, loin de nos proches, nous essayions de garder cela en tête ?






