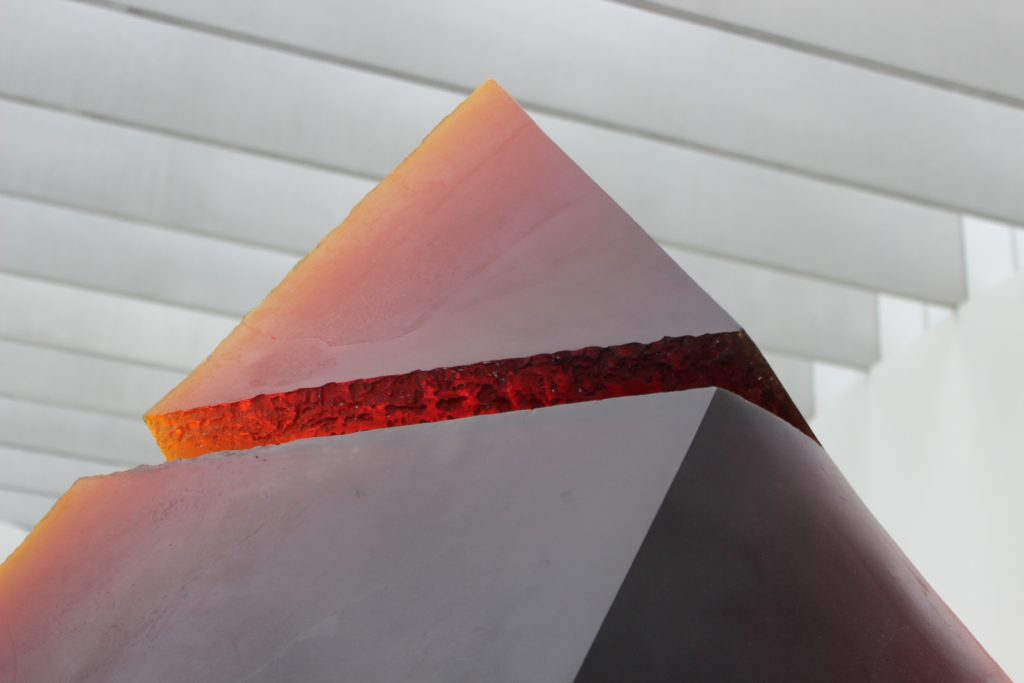
En politique, à gauche notamment, mais pas seulement, il est devenu à peu près impossible de défendre un programme ou une vision qui ne soient pas censés émaner de la « base ». Une base au sein de laquelle l’avis de chacun est aussi important que celui de n’importe quel autre. Seul celui des « sachants », suspect, forcément suspect, l’est presque un peu moins que les autres (et surtout s’il se présente comme tel). Aucune verticalité n’est tolérée. La moindre éminence doit être dénoncée. Personne n’a le droit de parler plus que les autres. Cette exigence d’absolue égalité s’est manifestée de façon particulièrement exacerbée à l’occasion de Nuit debout ou des manifestations des gilets jaunes. Chez ceux-ci certains leaders ont émergé, mais pour être aussitôt révoqués, déclarés non représentatifs et soupçonnés de n’agir que par intérêt personnel, matériel ou narcissique.
Bien sûr, il y a quelque chose de juste et de profondément légitime dans cet horizontalisme radical. D’un certain point de vue, en effet, celui du principe de commune humanité, tout autre humain vaut autant que tout autre être humain. Sa vie importe autant que celle de n’importe quel autre, et, en conséquence, son avis aussi. Cet avis renvoie à une expérience vécue singulière, qu’aucune autre ne remplace, et qui doit être prise en compte en tant que telle. Pour le dire différemment, dans un autre registre, le postulat d’égale valeur de toute opinion représente l’aboutissement logique de la dynamique démocratique analysée par Tocqueville, qui se caractérise par une haine du privilège étroitement associée à une égalité imaginaire des conditions.
Le génie de la bêtise
Mais jusqu’où ce postulat d’égalité absolue, qui découle du principe de commune humanité, est-il tenable ? Sa première limite, évidente, tient à l’écart, souvent abyssal, entre le droit et le fait. Tout le monde n’est pas aussi riche, aussi fort, aussi vif, etc. Tous ne sont pas autant informés, tous ne savent pas autant de choses. Mais parce que nul ne sait exactement ce qui constitue un savoir qui importe, parce que nul ne peut exclure que ceux qui savent ou croient savoir quelque chose d’important ne soient parfaitement idiots, parce qu’il peut exister aussi, également, un certain génie de la bêtise, et parce qu’en ces matières personne n’est autorisé à trancher, il faut bien poser comme principe démocratique de base, en effet, que sur les questions d’organisation de la cité, toute opinion est a priori légitime aussi longtemps que ces questions sont irréductibles à des considérations techniques et scientifiques. Dans celles-ci, en revanche, l’opinion non informée ne saurait en aucun cas se substituer à celle des savants ou des techniciens reconnus compétents. On n’abandonnera pas la construction d’un pont ou la réfection de la flèche de Notre-Dame à qui n’a pas fait d’études. Mais où passe la frontière entre le domaine du techno-scientifique et celui du politique à l’état pur, i.e. celui du libre choix des valeurs centrales ? La dessinera-t-on dans le langage de la science et de la technique, ou dans celui de la politique pure ? Et que se passe-t-il lorsque les conclusions des experts légitimes divergent, ce qui est fréquemment le cas [1] ?
Ces questions, bien connues, sont, on le sait, assez largement indécidables. Mais ce n’est pas là ce qui est le plus problématique dans la fétichisation de l’horizontalité et le refus de toute verticalité, refus qu’il convient d’analyser comme une dénégation du pouvoir. Une dénégation autodestructrice puisque par souci d’éviter que les Grands (comme le disait Machiavel) ne prennent et n’accaparent le pouvoir, elle aboutit en réalité à le renforcer. Ce qu’on désigne plus ou moins bien et clairement sous le terme de populisme peut sans doute s’analyser au mieux comme étant ce mouvement par lequel les Petits (toujours dans les termes de Machiavel) voulant échapper au désir de dominer qui anime les Grands, s’en remettent, pour les mater, à un plus grand qu’eux tous. Pour échapper au Pouvoir, on en crée un encore plus puissant et plus indéracinable.
Différence de plans
Un des premiers défauts du désir d’horizontalité c’est que celle-ci est largement fictive. Au mieux, elle conduit à l’impuissance, comme l’ont montré Nuit Debout et les Gilets jaunes. Très vite, les Gilets jaunes ont obtenu la satisfaction de leurs revendications matérielles immédiates, mais, une fois celle-ci acquise, ils se sont révélés dans l’incapacité de bâtir ne serait-ce que l’esquisse d’un programme politique. Un programme, ou même, en amont, un projet, une vision politique ne peuvent pas s’élaborer par simple agglutination des propositions ou des revendications des uns et des autres. Les idées, les valeurs ne sont pas toutes horizontales, elles. Certaines sont plus générales et englobantes que d’autres. Et il faut bien distinguer l’essentiel de l’accessoire, l’urgent du moins urgent, etc. Dans le monde des valeurs comme dans celui des concepts, tout n’est pas sur le même plan.
Du coup, deuxième défaut, passé un certain stade, l’horizontalité, devient illusoire, trompeuse et se renverse en son contraire. À Nuit Debout, certains avaient quand même plus droit à la parole que d’autres, sans compter qu’il a bien fallu des organisateurs pour gérer les tours de parole (ceci expliquant d’ailleurs cela). Emmanuel Macron s’est fait élire en prétendant avoir procédé à une sorte d’audit participatif géant de la société française dont il a tiré comme conclusion… le bien-fondé de son programme de départ. Il a réitéré le même exploit avec le supposé Grand Débat. Le plus grand pourfendeur du pouvoir personnel conféré au président de la République française, le plus ardent défenseur de l’horizontalité, Jean-Luc Mélenchon, est désormais clairement identifié, au sein même de son propre parti comme exerçant un pouvoir quasi absolu d’un type inédit, que l’intéressé qualifie de « gazeux ».
Plus généralement, et plus en profondeur, il est impossible de ne pas relever que ces formes de pouvoir qui ne s’assument pas comme telles sont assez largement celles qui s’exercent au sein des entreprises modernes, ou des administrations converties au New Public Management sous les égides de la « gouvernance ». Quel mot admirable qui laisse entendre qu’il n’y a pas de gouvernants, pas de pouvoir (et donc pas de responsables) et que les décisions se prendraient en quelque sorte toutes seules par simple remontée depuis la base !
« Exprimez-vous, formulez toutes vos propositions et préoccupations », dit le Sommet. « Les décisions prises ne seront que le reflet de vos contributions ». Hitler, déjà, disait qu’il ne décidait rien, qu’il ne faisait qu’écouter et traduire ce que disait ou lui soufflait le peuple.
Bien sûr, nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Les totalitarismes d’hier parlaient au nom de collectifs fantasmatiques, la race, le prolétariat, l’Etat, et leur sacrifiaient allègrement les individus. Nous vivons aujourd’hui sous la domination d’un totalitarisme à l’envers, d’un parcellitarisme, qui ne veut voir que des individus, ou des parcelles d’individus – « There is no such thing as society » –, et leur sacrifie tout ce qui est de l’ordre du commun et du collectif.
La question de la représentation
C’est sur ce point précis que la revendication d’horizontalité radicale montre ses limites les plus importantes. Elle entend rassembler le plus largement possible – « Tous ensemble, tous ensemble ! » – en n’excluant personne, mais elle se révèle incapable par nature de fabriquer des collectifs et a fortiori des collectifs durables. Un collectif, quel qu’il soit, ne peut exister que s’il se dit tel, que s’il est représenté par un nom, et des symboles. Et ces symboles eux-mêmes doivent être représentés et incarnés d’une manière ou d’une autre. Si personne n’est habilité à parler au nom du collectif et à le représenter, celui-ci n’existe tout simplement pas, ou simplement en rêve.
Que déduire de ces quelques remarques ? Comment gérer la tension entre un égal droit à la parole (l’isegoria des Grecs anciens), qui ne saurait être remis en cause, et la nécessité que certains parlent plus que d’autres parce que leur parole engage l’existence même du collectif ? Certainement pas en déniant l’existence ou la nécessité du pouvoir ou d’un leadership. La crainte qui anime la revendication d’horizontalité est que certains en viennent à exercer un pouvoir sur le collectif. Mais, dans le vain espoir de conjurer l’émergence de tout pouvoir sur, la fétichisation de l’horizontalité rend impossible le pouvoir de faire quelque chose ensemble. Il n’y a pas de pouvoir d’agir collectif possible sans que certains ou certaines exercent une forme ou une autre de pouvoir. Ce qui est à craindre et à conjurer ce n’est pas le pouvoir, c’est la transformation du pouvoir en domination, c’est-à-dire en un pouvoir sur qui ne bénéficie qu’à ceux qui l’exercent et non au pouvoir d’agir du collectif. Un pouvoir qui s’accapare et qui ne peut pas ou plus être contesté.
Comment empêcher cette transformation délétère du pouvoir en domination ? Il n’existe assurément pas de recette magique qui marcherait à tous les coups.
Mais la ligne générale à suivre n’est pas trop difficile à cerner. Elle avait déjà été parfaitement formulée par Aristote : il faut que tous, au sein du collectif, puisent, alternativement, être en position de commander ou d’obéir.
Commander ? Obéir ? De tels mots font frémir aujourd’hui parce qu’ils évoquent trop de dominations passées. Mais l’idée générale reste juste. Reste à la formuler en termes plus concrets et plus actuels, sachant que l’essentiel est de cesser de dénier le pouvoir pour mieux commencer à aménager son exercice en mettant la verticalité au service de l’horizontalité.
[1] La meilleure réponse, on le sait, passe par la constitution de jurys citoyens ou de conférences de consensus dans lesquels des citoyens ayant suivi une initiation de base rendent des conclusions après avoir entendu des experts de bord opposés. On n’est plus ici dans la pure horizontalité.
Alain Caillé (article paru initialement sur www.convivialisme.org)







