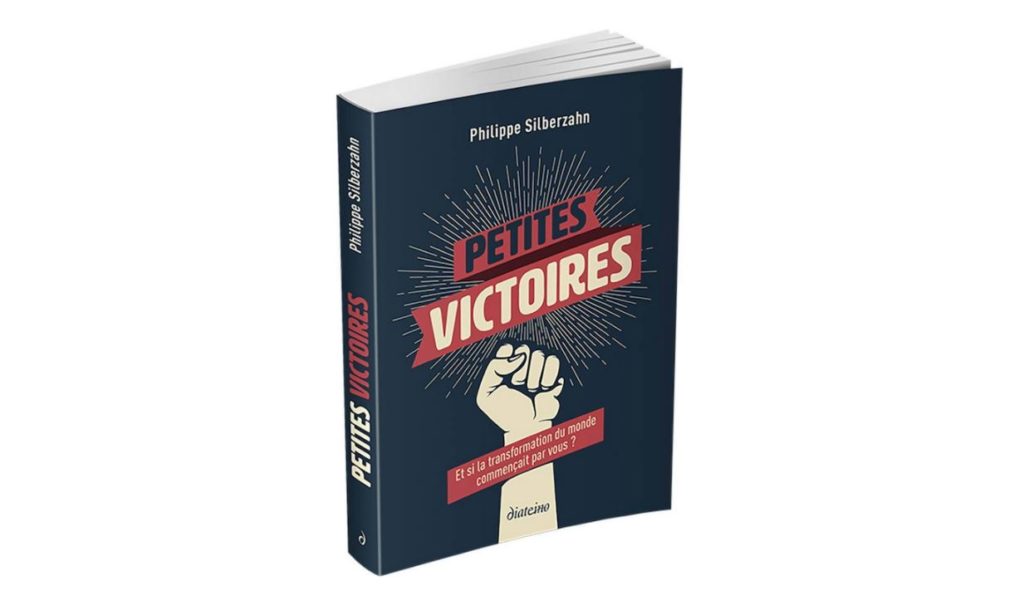
Une des plus grandes frustrations ressenties par ceux qui veulent faire bouger un collectif (organisation ou société) est que, bien qu’ils soient persuadés d’avoir raison, ils ont du mal à entraîner les autres dans l’action. Penser ainsi qu’il suffit d’avoir raison pour que tout le monde soit d’accord avec nous et nous suive est malheureusement faire preuve de naïveté, et surtout ignorer les enseignements de la sociologie pourtant déjà anciens. L’engagement dans l’action n’est en effet que très partiellement une question d’idée avec laquelle nous sommes d’accord. Nous ne comprenons en général les choses qu’en fonction de notre expérience vécue, c’est-à-dire de ce avec quoi nous sommes familiers. La prise en compte de cet aspect de la transformation est clé.
La plupart des activistes ont une approche très intellectuelle de la transformation. Il suffit, semblent-ils penser, de convaincre les autres de l’ampleur du problème et d’expliquer sa nature pour déclencher l’action. Ils se focalisent ainsi sur le problème lui-même, et non sur les gens qui pourraient le résoudre. Une telle approche devient rapidement incantatoire et rhétorique et a dès lors un impact très limité. C’est par exemple le problème lorsqu’on évoque le déficit public : 60 milliards d’euros est un chiffre tellement grand qu’il dépasse notre expérience ; la plupart d’entre nous est habituée à manipuler des centaines, voire des milliers d’euros et peut-être, une fois dans notre vie, pour l’achat de notre maison, des centaines de milliers d’euros, mais qu’est-ce qu’un milliard ? Que cinquante mille personnes meurent en Syrie nous semble largement abstrait, mais que le fils d’un voisin se fasse renverser par une voiture peut nous affecter profondément. C’est pour cela que l’activiste doit aborder les gens en fonction de leur propre intérêt. Les aborder de manière générale ou moralisatrice est peut-être satisfaisant, mais en dehors de leur expérience et donc stérile. On ne communique bien avec personne en se basant uniquement sur les faits rationnels ou l’éthique d’une question, ce que des esprits scientifiques ont toujours beaucoup de mal à saisir. Quand on essaie de résoudre un grand problème par des petites victoires plutôt que par un grand pari, celles-ci doivent être conçues à partir de l’expérience des gens.
Dans les années 1950, le sociologue et activiste américain Saul Alinsky est très impliqué dans la lutte contre la ségrégation et son approche repose sur les petites victoires. Une des victoires qu’il vise est d’amener des magasins ségrégationnistes à embaucher des personnes noires. Une façon de faire est la suivante : une fois identifié un magasin ségrégationniste, il demande à ses militants de s’habiller correctement, de le visiter le jour le plus important, le samedi, et de monopoliser les vendeurs le plus longtemps possible en posant une infinité de questions, puis de partir sans rien acheter. Non seulement les vendeurs sont occupés par des gens qui, finalement, n’achèteront rien, mais en plus les clients habituels, blancs, quittent rapidement le magasin en constatant qu’il n’y a que des clients noirs. L’impact économique se fait rapidement sentir et le magasin finit par recruter des employés noirs. Aucune loi n’est enfreinte et l’action reste dans le domaine d’expérience vécue des militants : il s’agit d’aller dans un magasin demander des informations sur un produit familier. La petite victoire est obtenue sans que les activistes ne se mettent en risque (légal ou psychologique) inacceptable ; ils restent dans le domaine de leur expérience vécue et changent le monde un magasin à la fois, petite victoire par petite victoire.
Envisager des actions en dehors de l’expérience vécue des parties prenantes est une source d’échec. Cela arrive très souvent lorsqu’un activiste impatient décide une action-choc. J’ai vécu cela dans une grande entreprise avec un manager qui était inquiet du fossé qui séparait le Comex (comité exécutif, la direction générale) de son entreprise, très conservateur, de la jeune génération de cadres très motivée par l’innovation et l’entrepreneuriat. Il propose un jour au Comex d’inviter l’un de ces jeunes cadres, appelons-le Martin, à lui présenter son projet. La proposition est acceptée sans difficulté. Le manager estime que ce sera une bonne expérience pour Martin et qu’il acquerra par la même une visibilité auprès de la direction générale qui favorisera sa carrière. Malheureusement, l’opération est un échec : l’enthousiasme de Martin passe mal auprès du Comex et les membres ne comprennent pas la moitié des mots qu’il prononce (agilité, intelligence artificielle, lean startup, preuve de concept, etc.) De son côté, Martin se sent comme devant un tribunal qui regarde sa présentation avec suspicion et conclut que les « vieux » du Comex sont bornés, méprisants et hostiles à l’innovation. Finalement, tout le monde est perdant : le Comex, car il a raté l’occasion d’établir un lien avec la jeune génération ; Martin, car il est désormais vu comme un geek immature ; et le manager, car il a grillé un membre prometteur de son équipe et qu’il a désormais une étiquette sur le dos de manager « qui ne contrôle pas ses troupes ». L’opération est un échec parce qu’elle se place en dehors de l’expérience des parties prenantes : Martin n’a pas les codes pour intervenir auprès du Comex et celui-ci n’a pas non plus les codes pour le comprendre. En substance, les modèles mentaux ne sont pas partagés. Se situant en dehors de l’expérience des parties prenantes, l’opération représente en fait une prise de risque inacceptable ; elle ne respecte pas le principe n° 2 de l’effectuation (toujours agir en perte acceptable). Elle est un grand pari, et non une tentative de petite victoire.
Créer une expérience commune d’abord
Lorsque vous essayez de communiquer avec une partie prenante et que vous ne trouvez pas le point où elle peut accueillir et comprendre ce que vous dites, vous vous situez en dehors de son expérience ; vous devez en créer un pour elle, ou, plus précisément, avec elle. Ainsi, notre manager aurait pu par exemple choisir un membre du Comex plus ouvert que ses collègues et l’inviter à passer une heure ou deux pour discuter avec l’équipe d’innovation, puis ouvrir un processus d’échange régulier informel avec lui, permettant des questions et des réponses et une familiarisation progressive des deux parties. En bref, quand il n’y a pas d’expérience commune, il faut la créer : c’est le rôle de l’activiste.
L’un des facteurs qui modifie ce que vous pouvez et ne pouvez pas communiquer avec succès, ce sont les relations. Il y a des choses que vous ne pouvez communiquer à quelqu’un que lorsque vous avez préalablement établi une relation avec lui. Les humoristes savent ainsi qu’il y a certaines blagues un peu crues qu’ils ne peuvent faire qu’en seconde partie de spectacle, lorsque la relation avec le public est suffisamment bien établie pour qu’elles « passent ». Avant cela, elles tomberaient à plat ou seraient mal reçues. Au travers de la relation, l’activiste doit établir sa légitimité, mais surtout permettre l’établissement d’un langage commun, c’est-à-dire de modèles mentaux partagés. Évidemment, les partager tous n’est pas indispensable pour établir une relation solide, un seul suffit. Dans l’exemple du Comex ci-dessus, l’idée qu’un lien productif existe entre celui-ci et les jeunes cadres suffit pour créer une expérience commune. Il n’est pas nécessaire que le Comex adhère à leur vision pour avancer dans cette direction. Pour viser une petite victoire, il suffit de s’accorder sur un tout petit aspect du problème général.
Avant tout, la relation
L’établissement d’une relation avec les parties prenantes est donc un préalable et constitue une part essentielle du travail de l’activiste. Elle permettra une familiarité et l’émergence de modèles mentaux communs, chacun comprenant mieux la perspective de l’autre et se faisant une joie de le côtoyer. Autrement dit, tout repose sur cette joie, et tous les moyens seront bons pour la développer : un café pris en commun, mini-séminaires informels, une partie de foot, un barbecue.







