
C’est un « pas de côté » que nous propose de réaliser le permaéconomiste Emmanuel Delannoy avec L’économie expliquée aux humains. Car lorsque la biodiversité elle-même, en l’occurrence l’insecte Cerambyx Cerdo, prend la parole pour évoquer la nécessité de changer de modèle économique, le message n’en a forcément que plus de poids… Retour sur le contenu de l’ouvrage avec son auteur.
Vous parlez dans votre ouvrage par la voix d’un capricorne, Cerambyx Cerdo. Que dirait-il face à l’actuelle crise sanitaire qui secoue le monde ?
Sans vouloir jouer les prophètes, un rôle toujours lourd à assumer, cette crise est révélatrice de la fragilité de ces systèmes interconnectés à l’échelle mondiale. Il y a quatre mois, ce virus était porté par une espèce de chauves-souris parmi des centaines d’espèces de chauves-souris dans un coin reculé de la Chine. A présent, c’est une menace en train de gripper la machine économique mondiale. Probablement, il faudra réfléchir à la façon dont on va, sans renoncer complètement à la mondialisation, ré-ancrer notre manière de créer de la valeur ajoutée. C’est un peu paradoxal ! On aura toujours des échanges mondiaux, mais il faudra qu’ils soient à bon escient. Et parallèlement, on va forcément aller vers des logiques de relocalisation de création de valeurs ajoutées… Même si c’est encore trop tôt pour tirer les enseignements de tout ça. Par ailleurs, puisque l’on parle de biodiversité, on peut voir que tous ces risques sanitaires, ils sont liés à la manière dont on interagit avec elle. Pour que ces virus viennent en contact avec l’homme, il faut qu’il y ait un vecteur. Or si on ne « déforestait » pas, si on n’était pas autant en contact avec des écosystèmes dans lesquels l’homme n’a finalement pas grand-chose à faire, le point de contact avec ce vecteur ne se ferait pas. On est donc bien sur une crise de la biodiversité, de la manière dont nous interagissons avec elle.
Vous dites que l’on « ne fera pas l’économie de la biodiversité ». Pourtant, de nombreuses démarches de reporting extra-financier s’appuient sur cette idée. Les entreprises doivent-elles revoir leur approche en matière de RSE ?
Evaluer, d’un point de vue monétaire, économique, la contribution de la biodiversité au bien-être humain, c’est un exercice utile, mais pas essentiel. Dans la sphère de l’entreprise, il n’y a pas de réponse unique. Si je transpose à l’humain, au bien-être des salariés, à l’éthique, aux droits de l’homme, à la diversité de genre, il y a des aspects que l’on ne peut valoriser d’un point de vue économique. A quelques exceptions près : par exemple, on a remarqué que des portefeuilles financiers gérés par des équipes de traders avec une diversité de genres plus importante étaient plus stables, moins sujets à des à-coups brutaux que des portefeuilles gérés uniquement par des hommes. Dans la RSE, il y a des choses que l’on peut mettre sous forme d’indicateurs, d’équations. Notamment s’il y a des ruptures d’approvisionnement, des pertes d’exploitations liées à des dégradations de services écosystémiques. Ce sont des choses que l’on peut monétariser, entrer dans un reporting, et sur lesquels on peut alerter les dirigeants pour anticiper les risques. Mais encore une fois, est-ce l’essentiel ? Car l’enjeu, c’est plutôt de préserver le bien commun, pour l’entreprise, mais aussi l’ensemble de la société.
Comment « parvenir à mobiliser l’intelligence collective, et non plus individuelle », comme vous le préconisez, au sein de l’entreprise ?
Dans le domaine de l’entreprise, il s’agit d’intégrer une diversité de regards. Il ne s’agit pas de considérer que tous les avis se valent, l’idée n’est pas de neutraliser la parole de l’expert, qui est là pour éclairer la décision, contribuer à cette intelligence collective. Mais après, en complément, il doit y avoir une écoute de la diversité des points de vue et là, tous doivent pouvoir s’exprimer, contribuer à une prise de décision collective. Et ce, même si un certain nombre de ces points de vue vont sembler irrationnels, puisqu’il y a des projections, des représentations, des dimensions éthiques, éventuellement spirituelles.
Sur le registre de la protection de la biodiversité, que peuvent faire les entreprises ?
Premier cas extrême, les entreprises, dont l’objet est d’être actif sur la protection de la biodiversité. Ce sont des activités qui vont émerger de plus en plus. L’autre cas extrême, ce sont ces entreprises qui se pensent complètement déconnectées de la biodiversité et qui se demandent ce qu’elles pourraient bien faire. Il faut dépasser cette impression de distance en réfléchissant au cycle de vie complet du produit ou du service. Toutes les entreprises peuvent faire cet effort d’introspection, d’analyse de leurs dépendances et de leurs impacts vis-à-vis de la biodiversité. Il y a des outils qui existent, des bureaux d’études qui peuvent faire ce travail-là. Une fois opérée cette analyse, on en déduit des plans d’action.
S’inspirer de la nature est la piste à suivre. Est-ce à la portée de n’importe quelle entreprise que de s’emparer du biomimétisme ?
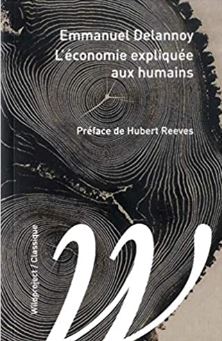
C’est en train de se développer très fortement. Pour autant, le biomimétisme ne doit pas en rester à une démarche où on irait puiser des bonnes idées dans la nature, mais sans que ça lui bénéficie. Par exemple, quand on utilise des micro-drones pollinisateurs pour se substituer aux abeilles dont les populations sont en déclin, il y a une démarche biomimétique. Mais on est ici en train de remplacer la nature par la technologie et d’un point de vue éthique, ce n’est pas acceptable. Pour démocratiser ça, il y a depuis quelques années une structure de coordination nationale, le Ceebios*, qui fait la promotion du biomimétisme. Elle anime une formation de quatre jours au design biomimétique. Il y a également un master animé et hébergé par l’Ensci, à Paris. On a donc une nouvelle génération d’ingénieurs et de designers qui vont être formés au biomimétisme et on a des possibilités d’avoir des formations continues.






